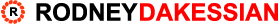L’État Arménien n’existait pas au moment de la perpétration du crime. C’est le 29 novembre 1920 que naît la République soviétique d'Arménie qui ne couvre qu'une petite partie du territoire historique de l'Arménie. Donc presque cinq années après le début des massacres et deux ans après l’achèvement des opérations de destruction qui ont touché les Arméniens ottomans. L’Arménie accède à son indépendance définitive le 21 septembre 1991.
L’histoire des Arméniens dans l’Empire ottoman débute sous le règne de Selim II (28 mai 1524-12 décembre 1574).
Les Arméniens habitaient sur leurs terres ancestrales depuis des millénaires, restant maîtres d’une nation souveraine. Les Turcs seldjoukides ont conquis l’ensemble de l’Arménie, qui était aux mains de l’Empire byzantin depuis 1045 jusqu’en 1064. Et avec le règne de Selim II, les Ottomans ont pris le contrôle de presque toute l’Arménie.
Les Arméniens ont préservé leur culture, leur histoire et leur langue, même sous domination ottomane, grâce à leur identité religieuse différente de celle de leurs voisins Kurdes et Turcs. Après tant d'années d'occupation turque, les territoires fortement peuplés par les Arméniens ont perdu leur continuité géographique (des parties des vilayets de Van, de Bitlis et de Harput) en raison de l'infiltration de Kurdes et de Turcs dans ces territoires. Malgré la domination ottomane et la présence musulmane de plus en plus imposante, les Arméniens ont continué de constituer le groupe ethnique majoritaire en Arménie occidentale, même durant le XIXe siècle. Ils ont gardé et défendu un certain degré d'autonomie dans des emplacements isolés comme Sassoun, Shatakh et une partie de Dersim. Zeitoun (Ulnia) était une « forteresse » arménienne et un symbole d'autonomie, située entre les six vilayets et la Cilicie (vilayet d'Adana), qui avait aussi une forte présence arménienne depuis la création de la principauté (puis royaume) arménienne de Cilicie. Cependant, à cause des interférences et du génocide par le gouvernement des Jeunes-Turcs de l'Empire ottoman, ces contrées ont perdu leur autonomie et leur population arménienne.
La population arménienne dans l’Empire ottoman avant 1915 contait entre un million et demi et deux millions et demi d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman avant le génocide.
Un recensement a été fait en 1912 sous le règne d’Abdülhamid II. Mais le fait que ce recensement ait été conduit sous le régime du sultan Abdülhamid II le rend douteux, selon les critiques. Des enregistrements turcs suggèrent aussi qu’Abdülhamid II ait intentionnellement sous-estimé la population arménienne.
L'auteur turc Kâzım Kadri écrit : « Durant le règne d'Abdülhamid nous avons abaissé les chiffres de population des Arméniens... ». Il ajoute « Par ordre d'Abdülhamid le nombre d'Arméniens a délibérément été abaissé » [].
Fa'iz El-Ghusein, ancien kaïmakam de Kharpout, a écrit dans son livre qu'il y avait selon les statistiques officielles ottomanes environ 1,9 million d'Arméniens dans l'Empire ottoman.[
Le patriarcat arménien a procédé à plusieurs recensements durant les dernières décennies du XIXe siècle : trois millions d'Arméniens selon les statistiques apportées par la délégation arménienne au congrès de Berlin (1878), deux millions six cents soixante mille selon une nouvelle statistique datant de 1882. Finalement, les sources du patriarcat arménien donnent une population arménienne d'environ deux millions cent mille personnes à la veille de la Première Guerre mondiale.
Vital Cuinet était un géographe français chargé d'observer certaines régions et d'estimer leur population. Ses études visaient aussi à déterminer la capacité de l'Empire ottoman à payer ses dettes. Il dût cependant conclure qu'il lui était impossible d'obtenir des chiffres précis, donnant deux raisons principales à cela :
- Les limitations imposées par les autorités ottomanes ne lui ont pas permis de mener des recherches concluantes.
- En raison du manque de contrôle des régions éloignées par les autorités ottomanes, il n'a pas pu compléter son travail.
Un exemple souvent cité par les critiques était les statistiques fournies par les autorités ottomanes concernant le vilayet d'Alep (classé dans ses travaux comme le sandjak de Marash) : il n'y aurait que 4 300 Arméniens dans cette région, alors que la ville de Marash comptait à elle seule 6 008 Arméniens catholiques et protestants, sans inclure les Grégoriens.
Au début de son livre, Cuinet prévient le lecteur : « La science des statistiques, aussi intéressante soit-elle, n'est non seulement pas utilisée dans ce pays mais en plus les autorités refusent d'y effectuer des recherches ».
Cuinet présente un nombre de 840 000 Arméniens pour le « villayet arménien » en 1891-1892, supérieur donc au nombre présenté par officiellement par les Ottoman [].
Ludovic de Contenson présente un nombre de 1 150 000 pour la partie asiatique de la Turquie, et appelle ce nombre « statistiques » sans présenter de source. Ses chiffres suggèrent qu'ils proviennent en fait des statistiques officielles ottomanes, sans correction [].
Henry Finnis Bloss Lynch, géographe et ethnographe britannique, en complétant ses propres études, arriva au nombre de 1 058 000 Arméniens au début des années 1890 dans l'Arménie ottomane.
Lynch évoquait, tout comme Cuinet, qu'il y avait apparemment une volonté délibérée de la part des Ottomans de sous-évaluer le nombre d'Arméniens. Néanmoins, les chiffres de Lynch étaient bien diffusés, mais il avertissait le lecteur concernant la fausse interprétation du terme Musulman, sachant que d nombreux Arméniens s'étaient convertis à l'Islam bien que continuant de pratiquer le christianisme arménien [].
Arnold Toynbee propose une fourchette entre 1,6 et 2 millions d'Arméniens, supposant que le nombre réel est plus proche de 2 millions pour l'Anatolie [].
Les chiffres officiels britanniques à l'ambassade se basaient sur des recherches telles que celles de Lynch. En les comparants aux chiffres ottomans, le professeur Meir Zamir conclut : « Les provinces de Van, Bitlis, Mamuretal-Aziz (Kharpout), Diyarbekir, Erzurum, et le district indépendant de Maraş, où les estimations britanniques sont 62% supérieures (847 000 comparé à 523 065) [...]. La sous-évaluation des données des populations non musulmanes apparait être intentionnelle » [].
L'encyclopédie Britannica elle-même considère le nombre de 1 750 000 comme « une représentation raisonnable de la population arménienne d'Anatolie avant 1915 ».
Le professeur allemand Herman Wambery, reconnu comme turcophile et ayant prétendument de bons rapports avec les autorités ottomanes, présente le nombre de 1 130 000 Arméniens dans l'Empire ottoman en 1896 [].
Samuel Cox, de l'ambassade des États-Unis à Istanbul entre 1880 et 1886, estime la population arménienne dans l'Empire à 2,4 millions.[
Les massacres ont été commis contre des Arméniens ottomans, vivant dans l’Empire ottoman. Donc, si on se place au moment actuel, quel État est en droit de réclamer les droits des victimes ? Est-ce l’Arménie, et pourquoi ?
En lumière de la théorie des obligations erga omnes, on peut dire que tout État est en droit de réclamer la protection de l’ordre international et de lutter contre les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide.
Et comme c’est déjà vu antérieurement, l’article 48 du projet de la C.D.I. admet que « tout État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État si :… b) l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble ». Cette disposition vise, sans s’y limiter, les violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général et, plus généralement, la violation des obligations erga omnes. Comme la C.I.J. l’a déclaré dans l’affaire de la Barcelona Traction :
« Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes ».
La Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide est une norme impérative du droit international général, qui crée des obligations erga omnes. La violation des obligations découlant de cette norme confère à tous les États le droit et l’intérêt juridique de protéger ces droits et ces obligations.
Et comme c’est déjà cité précédemment, la C.I.J. a estimé, lors de son avis consultatif relatif aux Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 28 mai 1951 que, « dans une telle convention, les États contractants n’ont pas d’intérêts propres, ils on seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont les raisons d’être de la Convention ». Dans le cadre de l’article 55 de la Charte des Nations Unies, l’Assemblée générale est chargée de promouvoir les droits de l’homme, l’O.N.U. a élaboré diverses conventions dont parmi eux celle relatif à la prévention et à la répression du crime de génocide, dont plusieurs gouvernements et États ont exprimé leurs réserves et leurs objections sur les effets juridiques de cette Convention.
L’Assemblée générale, par une résolution adoptée le 16 novembre 1950, a posé ce problème à la C.I.J. Cette Cour a d’abord mit en relief le principe de base du droit international conventionnel, par lequel un État ne peut être lié dans ses rapports conventionnels sans son consentement. Mais elle a aussi confirmé que ces règles de base doivent être assouplies dans le cas présent.
Le caractère universel des Nations Unies, la recherche d’une très large participation à cette Convention, la pratique récente suivant laquelle on peut être partie à une convention bien qu’ayant faite des réserves, et enfin le fait que la Convention sur le génocide est le résultat d’une série de votes majoritaires constitue autant d’arguments qui militent en faveur d’un assouplissement dans le jeu des conventions multilatérales.
Ensuite, la C.I.J. a étudié la question de savoir si l’on pouvait admettre le principe même des réserves en ce qui concerne la Convention sur le génocide. Aucun article ne les interdit ni ne les permet. Mais le Secrétaire général dans ses commentaires en avait envisagé la possibilité, tandis que certains représentants – sans susciter d’opposition majeure – avaient laissé entrevoir qu’ils ne pourraient signer ou ratifier sans faire de réserves. Si le principe est admis, dans quelle mesure est-il possible d’apporter des réserves à cette Convention ?
Ceci dépend des traits particuliers à chaque convention. Celle qui est en cause vise à empêcher la destruction de groupes humains entiers ; les principes qui sont à sa base sont reconnus par les nations civilisées comme engageant même en dehors de tout lien conventionnel, ce qui commande la plus grande universalité possible de la Convention. Les États n’y ont pas d’intérêts propres, il n’y a pas à se soucier d’un équilibre entre des droits et des obligations. Ceci montre assez que l’exclusion d’un État qui a fait une réserve ébranlerait l’autorité morale de la Convention ; mais on ne peut pas non plus la défigurer sous le prétexte d’une plus grande universalité. Le critère à retenir, en ce qui concerne les réserves, est donc la compatibilité de cette réserve avec les fins de la Convention.
Cependant, et selon les conditions d'application de la théorie de la « protection diplomatique », il faut que les victimes soient des ressortissants de l'État lui-même et ayant sa nationalité; et ceci a été confirmé par la C.I.J. en 1970 dans l'affaire de la Barcelona Traction. En d’autres termes, l’État ne peut exercer sa protection diplomatique qu’au profit de ses nationaux, c’est-à-dire des personnes physiques et morales qui sont rattachées à lui par un lien de nationalité ou d’immatriculation – son substitut pour certains engins tels que navires, aéronefs, fusées et satellites. Ce lien lui permet d’affirmer sa compétence personnelle, fondement de l’exercice de la protection diplomatique.
La jurisprudence internationale est cependant constante sur ce point. Elle s’exprime de façon catégorique : « en l’absence d’accords particuliers, seul le lien de nationalité donne à l’État le droit de protection diplomatique ».
Alors que dans le cas présent, les victimes du crime de 1915 ne sont pas des ressortissants de l’État arménien, car comme c’est déjà noté, l’État arménien n’existait pas au moment de la perpétration du crime.
Cependant et selon la jurisprudence, ce principe ne peut s'appliquer que dans des matières commerciales et financières, et pas dans des cas de crimes internationaux graves et de violations à des obligations émanant de normes impératives de droit international général.
Pour cela, la situation change si l'on se place dans le cas de la violation par un État d'une obligation qu'il a de respecter erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous les autres sujets de l'ordre juridique international.
Un État a le droit d'exercer la protection sur les victimes d'un génocide qui sont rattachés à lui par un lien légal, évident, religieux ou ethnique. Et ce lien existe pour l'État arménien, surtout que les victimes du crime étaient des Arméniens ottomans, c’est-à-dire des gens qui parlaient l’arménien, écrivait l’arménien, avaient des écoles arméniennes, une culture arménienne, des églises, des couvents, des maisons ainsi que des immeubles.
Dans ce contexte, il convient de citer le cas du procès d’Adolf Eichmann, comparu en justice devant une cour israélienne le 11 avril 1961, où la cour a affirmé le droit d’Israël à juger et à exercer le principe de la protection sur les ressortissants juifs massacrés lors du Holocauste en 1942 par le régime nazi.
Adolf Eichmann a été arrêté en 1961, transporté de l’Argentine en Israël pour être juger sous la loi israélienne pour son rôle dans l’Holocauste. Il été juger selon la loi de « condamnation des nazis et complices nazis de 1951 » qui a été rédigée selon les conditions de la Convention pour le génocide de 1948. Il a été accusé selon quatre accusations rattachées au génocide, et cela à la base de l’alinéa 4 article 2 de la Convention : massacres des juifs, atteinte grave à leurs intégrités physiques et mentales, soumission intentionnelle des juifs à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, et enfin des mesures visant à entraver leurs naissances au sein de leur société.
Dans ce cas pareillement, Israël n’existait pas lors de la perpétration des massacres. C’est en 1948 que son indépendance a été déclarée et que sa reconnaissance internationale a eu lieu. Et malgré cela, des remboursements ont été faits par l’Allemagne en tant qu’État successeur du régime nazi, envers les israéliens, vu qu’ils se rattachent avec les victimes par un lien religieux, ethniques et culturel.
Ainsi, l’Arménie est rattachée aux victimes du crime de 1915 par un lien ethnique, religieux, linguistique et culturel efficace, surtout que plusieurs des successeurs des victimes du génocide portent la nationalité arménienne et donc l’Arménie possède la qualité et l’intérêt juridique – surtout selon les articles 42 et 48 du projet de la C.D.I. déjà cités – au droit à l’action en responsabilité.
Rodney Dakessian
Beyrouth le 11-Octobre-2013