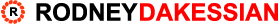Les crimes contre l’humanité et précisément le crime de génocide ne se prescrivent pas. C’est aussi l’une de leur originalité.
La Convention du 26 novembre 1968, sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; vu la gravité de ces crimes et « la nécessité de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales, de même que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées » ; est venue complétée la Convention de 1948 sur le crime de génocide ainsi que les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, de même que les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d'apartheid, et aussi les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité.
La Convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité déclare en effet à son article 1er que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité « sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis ». De plus, et l’argument semble imparable, il n’existe pas de prescription dans le droit de la responsabilité internationale des États. Or c’est bien la responsabilité de l’État turc qui est en jeu.
Cette Convention a été signée à New York le 26 novembre 1968 par neuf États signataires et 48 parties. Elle a été entrée en vigueur le 11 novembre 1970, conformément à l’article VIII.
La « protection internationale des droits de l’homme » implique essentiellement la reconnaissance à l’individu considéré en tant que tel et abstraction faite de ses appartenances nationale, ethnique ou autres, d’un certain nombre de droits considérés comme fondamentaux et nécessaires à la vie en société. Tantôt elle s’analyse comme un ensemble de libertés qui limitent les ingérences de l’État, tantôt elle suppose l’octroi par l’État à l’individu de biens et de services. Telle apparaît sous ses deux pôles, négatif et positif, la sauvegarde mise en œuvre. On peut, en outre, établir une autre distinction : entre « droits d’existence », absolument indispensables à la survie matérielle et civile de l’individu, et « droits de développement » qui ont pour objet d’assurer son mieux-être social.
Quintano-Ripollès a émis l’avis, en 1956, qu’ « un signe caractéristique de la nouvelle justice internationale (…), c’est qu’elle ne peut pas se situer au stade des attendrissements et des déclamations humanitaires où depuis un certain temps est tombé, pour des causes diverses, politiques plutôt que scientifiques, le droit criminel national ».
Lacconia souligne que la reconnaissance des droits de l’individu envisagé comme membre d’une communauté interétatique suppose la répression des crimes juris gentium et Karel Vasak montre bien comment, dans l’esprit des Européens, l’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité ne constitue qu’un aspect parmi d’autres de la protection internationale des droits de l’homme.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la question de la répression des crimes de guerre et contre l’humanité n’a pratiquement pas été posée sous l’angle de leur prescription, ni sur le plan des conventions internationales, ni sur le plan législatif interne. Sans doute pensait-on généralement, en 1945, qu’en quelques années les individus qui s’étaient rendus coupables de crimes de guerre seraient jugés et châtiés.
La tâche s’est avérée, à l’examen, beaucoup plus lourde qu’on ne pouvait le prévoir. Aussi l’intérêt des législateurs pour ce problème ne s’est-il guère manifesté avant 1964.
Tout naturellement, aussi, les premières initiatives prises en l’occurrence le furent dans le cadre d’États qui avaient des raisons politiques d’agir ou que les actions du régime nazi avaient plus particulièrement traumatisés, à savoir Israël et certains pays de l’Est. Un État s’est montré plus prompt à légiférer, celui-là même qui est, d’une certaine manière, issu de la conflagration de la seconde guerre mondiale et, singulièrement, de ses sinistres conséquences pour le peuple juif, c’est l’État d’Israël. Une loi, rétroactive, S-710 de 1950, modifiée en 1963, a attribué compétence aux tribunaux israéliens pour connaître fondamentalement de trois sortes de crimes commis, en dehors du territoire israélien, sous le régime national-socialiste :
- Les « crimes contre le peuple juif » (à savoir les diverses atteintes portées à l’intégrité physique et mentale des Juifs, telles qu’elles ont été cataloguées par la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948) ;
- Les « crimes contre l’humanité » et les « crimes de guerre » tels qu’ils ont été formulés dans l’article 6 du Tribunal militaire international.
Au printemps de 1964, la Pologne fut la première à réagir à l’approche de l’échéance prescriptive de 20 ans que sa législation, comme celle de beaucoup d’autres États, prévoyait pour les crimes passibles de la peine de mort ou de l’emprisonnement a perpétuité.
Selon M. Kubicki, près de 4.500 criminels de guerre nazis avaient été condamnés entre 1944 et 1960 par les tribunaux polonais. Pour la poursuite de l’œuvre répressive, la Pologne dépendait du bon vouloir de certains États, dont au premier chef l’Allemagne fédérale, susceptibles d’extrader les criminels qu’elle réclamait. Certaines difficultés et certaines lenteurs s’étant alors manifestées, l’État polonais ne pouvait guère espérer clore le dossier de la répression des crimes de guerre nazis avant l’échéance du 8 mai 1965 prévue par le Code pénal. La Diète polonaise a, en conséquence, adopté le 22 avril 1964 une loi ainsi libellée :
« Afin d’empêcher que les criminels nazis, coupables des plus grands crimes commis durant la seconde guerre mondiale, échappent à la justice, il est décrété que, en ce qui concerne les coupables (d’avoir pris part à l’assassinat de personnes faisant partie de la population civile, ou de soldats, ou de prisonniers de guerre en facilitant la tâche des autorités nazies), la prescription fixée par le Code pénal à ses articles 86 et 87, n’est pas applicable au cas où les poursuites n’auraient pas été entamées ou menées du fait que le contrevenant n’a pas été découvert, appréhendé ou extradé ».
Dans ce domaine, et en réponse au questionnaire relatif à la prescription qui lui a été soumis par le Secrétaire général des Nations Unies, le gouvernement tchécoslovaque a rappelé que la poursuite des criminels de guerre s’était accomplie en Tchécoslovaquie, sur la base de décrets présidentiels du 19 juin 1945 dont l’un (no 16) stipule à son article 17 que « la poursuite des crimes définis par le décret et l’exécution de la peine sont imprescriptibles ».
En faisant expressément référence aux règles du droit international, le législateur tchécoslovaque a précisé par une loi no 184 de 1964 qu’il excluait toute prescription de la poursuite judiciaire des actes criminels les plus graves contre la paix, les crimes de guerre et contre l’humanité commis au profit des occupants ou à leur service : ni l’action publique du chef de ces crimes ni l’exécution des peines prononcées à leur propos ne se prescriront.
De même en Hongrie, et après avoir, dès le lendemain de la guerre, entrepris avec ténacité la répression des crimes de guerre et l’avoir menée à bien dans le plus grand nombre de cas, les autorités hongroises n’ont pas voulu permettre que les criminels qui avaient échappé avant la fin de 1964, en fuyant à l’étranger ou par d’autres moyens, puissent se soustraire à la justice du pays. Les dispositions légales en vigueur alors – un décret 81 de 1945, une loi no 7 et un décret 1440 de la même année, une loi no 34 de 1947 – embrassaient, bien que sous des vocables différents, l’ensemble de la criminalité de guerre telle qu’elle a été définie dans le Statut du Tribunal militaire international.
La répression des crimes de guerre s’est réalisée en France par la loi du 26 décembre 1964. Faisant suite aux travaux entrepris, sous la direction de M. Maurice Rolland, conseiller à la Cour de cassation de France, par l’Amicale des magistrats résistants et par la Commission juridique de l’Association nationale des combattants volontaires de la Resistance, ainsi qu’à une résolution du bureau du Comité d’action de Résistance judiciaire française, une proposition de loi fut déposée, le 25 juin 1964, devant l’Assemblée Nationale française, par MM. Paul Coste-Floret et Schmittlein. Celle-ci tendait « à rendre non prescriptibles le génocide et les crimes contre l’humanité ».
L’article unique de la proposition de loi portait initialement que « le génocide et les crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 14 décembre 1948 sont imprescriptibles » et le recours à cette résolution, pour définir le génocide et les crimes contre l’humanité, était considéré comme nécessaire par l’exposé des motifs. En fait, la résolution visée (et qui date en réalité du 9 décembre 1948) est la résolution 260 (III) A, de l’Assemblée qui approuve le texte, annexé, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce texte, s’il définit à son article II le crime de génocide, ne définit pas le crime contre l’humanité. C’est pour cette raison, sans doute, qu’en présentant à l’Assemblée Nationale le rapport relatif à sa proposition de loi, M. Coste-Floret proposa un texte dont les références étaient modifiées. L’article unique de cette proposition porte, en effet, à ce stade de la procédure parlementaire, que « les crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité telle qu’elle figure dans la Charte du Tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature.
Ce texte ne sera plus modifié et deviendra celui de la loi du 26 décembre 1964.
La définition des crimes contre l’humanité à laquelle se réfère le législateur français est celle qui est formulée à l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international. Celui-ci ne parle pas du génocide qui n’est qu’un aspect particulier du crime contre l’humanité et constitue une notion qui ne fut dégagée qu’après le procès de Nuremberg. M. Herzog rappelle que la résolution des Nations Unies à laquelle se réfère le législateur a été prise au cours du procès de Nuremberg et a trait à la livraison des criminels de guerre. Mais, après que le jugement eut été rendu, l’Assemblée des Nations Unies, le 11 décembre 1946, crée, par une résolution 94, une Commission pour le développement progressif du droit international et, par sa résolution 95, elle a invité cette Commission à procéder à une « codification générale des principes reconnus dans le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal ». Et le magistrat français observe : « On peut donc négliger le problème des nuances apportées à la notion de crime contre l’humanité par les définitions successives du Statut du 8 août 1945 et du Jugement du 1er octobre 1946 ».
Le mérite essentiel du législateur français restera d’avoir été le premier du bloc occidental à avoir consacré sur le plan interne des principes inspirés du droit des gens et cela tout en indiquant les insuffisances de cette solution, précisément. Il n’est pas interdit de penser que cela n’aura pas pesé pour peu dans l’adoption ultérieure par le Conseil de l’Europe et les Nations Unies de textes de portée analogue. En tout état de cause, les juristes qui ont rencontré à Strasbourg, en février 1965, des collègues allemands, pour débattre ensemble du problème de la prescription, auront pu utilement faire référence à cet important précédent et fonder sur celui-ci leur attitude.
Prise avant la fin de l’année 1964, l’initiative du législateur français l’a un peu posé en précurseur sur le plan international. Ayant prétendu se référer au droit international et le mettre en œuvre, ayant cristallisé en droit interne le dernier état de la question en droit des gens, le législateur français a conduit le combat en avant-garde.
Tout s’est un peu passé, en effet, comme s’il avait paradoxalement imposé l’existence de cette solution inspirée du droit pénal international aux autorités mêmes qui sont chargées de formuler celui-ci.
Les organisations internationales doivent, on le sait, rassurer bien souvent les États, sourcilleux, vétilleux, jaloux de leur souveraineté, lorsqu’elles imposent des solutions inspirées du droit des gens. Cela explique la lenteur de l’évolution, les décalages inévitables avec lesquels les États admettent l’intégration des principes du droit international dans leur propre droit (en attendant qu’ils acceptent la primauté de l’un sur l’autre). Or, dans le cas qui nous occupe, c’est un législateur interne lui-même qui a indiqué la voie à suivre.
L’ex-Union soviétique, en réaffirmant solennellement le principe de l’imprescriptibilité dans le cadre de son droit interne, a entendu faire référence à une règle de droit déjà bien établie en droit international et plus particulièrement par les déclarations et accords des Puissances alliées, par le Statut et les décisions des tribunaux militaires internationaux ainsi que par diverses résolutions de l’Assemblée générale de l’O.N.U.. Même si de réelles précisions touchant à la prescription n’ont pas été formulées dans ces textes, les autorités de l’ex-Union soviétique déduisent manifestement l’imprescriptibilité des crimes nazis de ce que ces textes insistent tous sur la profonde nécessité de leur châtiment.
Dans l’exposé des motifs du décret adopté, le 4 mars 1965, par le Présidium du Soviet suprême, l’ex-URSS est du reste posée en « peuple le plus éprouvé par la guerre ». Aussi ce peuple, « se voulant particulièrement fidèle aux normes du droit international », réclame-t-il le châtiment des « criminels hitlériens, où qu’ils se trouvent et sans s’occuper de savoir depuis combien de temps ils se soustraient à la justice ». En conséquence de quoi, le Présidium décide : « que les criminels nazis qui ont commis des forfaits monstrueux contre la paix et contre l’humanité, ainsi que des crimes de guerre, doivent être livrés à la justice et châtiés, quel que soit le délai qui se sera écoulé depuis la date où leurs forfaits ont été commis.
Cette disposition apparaît libellée de façon assez vague. Elle embrasse l’ensemble des crimes internationaux tels qu’ils ont été formulés par le Statut du T.M.I. : crimes contre la paix, crimes de guerre et contre l’humanité commis dans le cadre de la seconde guerre mondiale mais sans mention des limites de temps entre lesquelles il faut concevoir celle-ci.
En Bulgarie, un texte a été également adopté le 22 mars 1965, par le Présidium de l’Assemblée générale bulgare, évoquant cependant avec plus de précision la nature même des crimes commis : massacre des populations civiles, crimes et persécutions racistes, extermination des prisonniers de guerre et des otages, tortures, destructions des biens culturels… Référence est faite, ici aussi, pour fonder la répression qui doit, à l’avenir comme par le passé, s’accomplir à l’égard de ces crimes, aux actes internationaux adoptés durant et au lendemain de la 2ème guerre mondiale et, plus particulièrement, à la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, aux Accords de Potsdam du 2 août 1945, à l’Accord de Londres et au Statut du T.M.I. du 8 août 1945.
Le dispositif du décret stipule que :
« La prescription est inapplicable aux crimes contre la paix et l’humanité, ainsi qu’aux crimes de guerre et les criminels nazis et fascistes seront punis indépendamment du laps de temps s’étant écoulé depuis la perpétration de ces crimes ».
Cependant, en Ex-Yougoslavie, la législation pénale réserve une place particulière aux « infractions contre l’humanité et contre le droit des gens », au chapitre XI du code de 1951. Les dispositions de ce chapitre sont inspirées des textes des Conventions humanitaires de 1949 et de la Convention sur le génocide de 1948 mais, à l’instar de ces textes, ne disaient rien de la prescription. Aussi, par une loi du 4 avril 1965, le législateur a ajouté au chapitre existant un article 134 qui prévoit l’imprescriptibilité des poursuites et de l’exécution des peines en ce qui concerne les crimes de guerre et le génocide. Cette disposition vise en fait aussi les crimes contre l’humanité mais fait abstraction des crimes contre la paix.
L’aspect sûrement le plus remarquable de cette loi, c’est qu’elle ne dispose pas seulement pour le passé, mais aussi pour l’avenir et qu’elle consacre donc une attitude de principe.
En Autriche, soulignons d’emblée que la prescription des peines n’existe pas. Le problème ne s’est donc posé qu’en ce qui concerne la prescription de l’action publique. L’article 231 du Code pénal déclarait imprescriptibles les crimes punis de la peine de mort : celle-ci ayant été abolie par une loi du 21 juin 1950 qui lui a substitué la peine de réclusion à perpétuité. C’est l’imprescriptibilité de ces crimes qui a été consacrée par la loi du 31 mars 1965. Cette disposition embrasse bien les crimes de guerre et contre l’humanité tels qu’ils sont entendus au sens du droit international.
L'article 29 du Statut de la Cour Pénale Internationale dispose : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». Cependant, la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu de son Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b)Les crimes contre l’humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d’agression.
Cette disposition est originale à plusieurs titres :
- Il s'agit tout d'abord d'une nouveauté par rapport au Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et au Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) dont les statuts ne comportent aucunes dispositions relatives à la prescription de l'action publique et de la peine.
- Ratione materiae (compétence d’attribution) son champ d'application est plus large que celui de la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (entrée en vigueur le 11 novembre 1970).
- L'article 29 s'applique, en effet, au génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et agression.
Cependant, et à la différence de la Convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 qui prévoit une application rétroactive de ses dispositions pour couvrir même les crimes commis avant son entrée en vigueur, l'article 29 du statut de la C.P.I., combiné avec les articles 11 et 24 qui précisent que la compétence de la C.P.I. se limite aux crimes commis après son entrée en vigueur, ne prévoit pas de rétroactivité.
On rappellera que pour la plupart des États la condition de non rétroactivité a même été la condition sine qua non de leur participation au statut de la C.P.I.
Le Conseil de l’Europe a suivi les mêmes pas vu la nécessité de sauvegarder la dignité humaine en temps de guerre comme en temps de paix.
Pour cela, une Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre a été signée le 25 janvier 1974 à Strasbourg.
Son article premier stipule que : « Tout État contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale:
1. les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies ; … ».
La France a pourtant précédé même les Nations Unies dans le sujet de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.
Le 26 décembre 1964, la loi no 64-1236 signée par le Sénat énonçait dans son article unique que, les « crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ». Comme le relevait alors le sénateur Louis Namy, en 1964, un criminel de guerre sur sept avait été poursuivi et condamné et près de 100.000 criminels de guerre échappaient encore aux poursuites.
En fait, comme l'a rappelé la Cour de cassation, la loi du 26 décembre 1964 s'est bornée à confirmer une imprescriptibilité déjà acquise, en droit interne, par l'effet des textes internationaux auxquels la France avait adhéré.
En 1992, le nouveau code pénal (article 213-5) consacrait l'imprescriptibilité de l'action publique et des peines en matière de crimes contre l'humanité sans renvoyer, comme le faisait la loi de 1964, à la définition retenue dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 afin de marquer sans ambiguïté que le « droit de Nuremberg » est « un droit du passé comme un droit de l'avenir, c'est un droit naturel qui possède la dimension « spatio-temporelle » d'un droit international universellement reconnu, à la mesure des crimes dont il assure la protection ».
Soucieux de préserver la spécificité du crime contre l'humanité, le législateur français s'est toujours refusé, jusqu'à présent, à élargir les bornes de l'imprescriptibilité.
L’enchaînement des initiatives prises, tel que nous l’avons retracé, atteste clairement une convergence : dans la généralité des cas, on a conclu à l’opportunité voire à la nécessité de saisir les Nations Unies de la question afin qu’elles lui donnent, de manière privilégiée et, à la limite, discriminatoire, les suites qui s’imposent. Quelquefois, on l’a constaté, d’autres organisations se sont gardées de prendre elles-mêmes position, en laissant à l’organisation mondiale le soin de s’en charger. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on attendait donc avec une certaine impatience et même une fébrilité certaine l’aboutissement de ses travaux.
Conformément à la Résolution 3 (XXI) de la Commission des droits de l’homme, une étude a été préparée par le Service juridique du Secrétaire général des Nations Unies. Elle porte essentiellement sur les procédés juridiques permettant de consacrer l’imprescriptibilité de ces crimes en droit international.
Le 26 novembre 1968, l’Assemblée générale, par une Résolution 2391 (XXIII), a adopté la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et l’a ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des États qui ont qualité pour y devenir parties.
Le groupe de travail constitué par la Commission des droits de l’homme n’ayant pas pu, comme nous l’avons constaté, se mettre d’accord sur une définition des crimes contre l’humanité, ni la Commission elle-même ni le Conseil économique et social n’ont pu venir à bout de leur tâche. C’est pourquoi le Conseil a chargé l’Assemblée générale du soin de rédiger elle-même celle-ci, par une Résolution 1220 (XLII) du 6 juin 1967. Dès sa vingt-deuxième session, l’Assemblée a saisi sa troisième commission (dite des « Questions sociales, humanitaires et culturelles ») de ce problème en recommandant aussi qu’un groupe de travail mixte soit créé par cette commission conjointement avec la sixième commission (dite des « Questions juridiques ») pour élaborer le projet définitif. Le groupe de travail composé de 15 membres a adopté ce projet par 8 voix (celles du Dahomey, de la Guinée, de l’Inde, du Liban, de la Pologne, de la République arabe unie, de la Tanzanie et de l’ex-URSS) contre zéro mais avec 7 abstentions (celles des États-Unis, de la France, du Mexique, des Pays-Bas, du Pérou, des Philippines et du Royaume-Uni).
Ce groupe de travail n’avait pour autant pas fait disparaître du texte dont il était l’auteur les contradictions auxquelles s’était trouvée en butte la Commission des droits de l’homme : le texte adopté – et, partant, celui de la convention elle-même – reflète au contraire très exactement ces distorsions et l’amalgame qui en est résulté, particulièrement quant à la définition des crimes contre l’humanité.
À la troisième commission, les pays de l’Est et afro-asiatiques défendirent le projet ainsi conçu par le groupe de travail mixte en se heurtant aux objections formulées par les pays occidentaux et latino-américains qui déploraient l’imprécision juridique de l’instrument ainsi que la rétroactivité absolue de ses effets. Une résolution de caractère procédural, introduite par le Liban, le Nigéria et la Tanzanie, transmit cependant à la vingt-troisième session de l’Assemblée la tâche de la mise au point définitive de l’instrument. Cette résolution a été adoptée par 90 voix contre 2 (celles de l’Afrique du Sud et du Portugal) avec 22 abstentions.
À la troisième commission, un premier vote séparé est intervenu sur le premier alinéa du préambule, qui apparaissait comme l’un des plus sujets à caution aux yeux des représentants occidentaux, en raison des références qui y sont faites aux Résolutions 2184 (XXI) et 2202 (XXI) de l’Assemblée générale, sur la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et sur la politique d’apartheid. Cette disposition a été adoptée par 59 voix (celles des pays de l’Est et de la plupart des États afro-asiatiques plus celles de l’Autriche, du Chili, de la Grèce et de la Turquie) contre 6 (celles des États-Unis, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et du Royaume-Uni) et 25 abstentions (émanant de la plupart des pays occidentaux et latino-américains ainsi que de l’Afghanistan, de la Chine et du Japon). Le préambule dans son ensemble a été adopté par 58 voix contre 2 et 27 abstentions.
L’article premier qui décrète l’imprescriptibilité absolue des crimes de guerre et contre l’humanité, dans l’acception large approuvée par la majorité des États, a été adopté par 59 voix (celles des pays de l’Est et afro-asiatiques) contre 12 (Afrique du Sud, Australie, Belgique, Canada, États-Unis, France, Honduras, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) et 27 abstentions (Argentine, Autriche, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Danemark, Équateur, Espagne, Finlande, Grèce, Guatemala, Guyane, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pérou, Philippines, République dominicaine, Suède, Turquie, Uruguay et Venezuela).
Les autres dispositions normatives du traité, sur la participation en tant qu’auteurs ou complices aux crimes susvisés, sur les dispositions à prendre à l’échelon interne pour permettre l’extradition des auteurs de ces crimes et sur l’abolition des prescriptions déjà intervenues, bien que paraissant moins, à l’exception de cette dernière, sujettes à controverses, ont été adoptées par des votes qui reflètent pareillement le caractère irréconciliable des thèses en présence.
La Commission a adopté l’ensemble du projet par 58 voix (celles des pays de l’Est et des pays afro-asiatiques ainsi que celles du Chili, de la Grèce, du Mexique et des Pays-Bas) contre 6 (celles de l’Afrique du Sud, de l’Australie, des États-Unis, du Honduras, du Portugal et du Royaume-Uni), avec 32 abstentions (Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Barbades, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Finlande, France, Guatemala, Guyane, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Luxembourg, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, République dominicaine, Swaziland, Suède, Turquie, Uruguay et Venezuela).
En séance plénière, l’Assemblée a adopté la convention par 58 voix contre 7 et 36 abstentions. Seuls quelques États ont voté en l’occurrence différemment qu’en commission. Ainsi la Grèce et les Pays-Bas, qui avaient voté en faveur du projet en commission, se sont paradoxalement abstenus lors du vote en séance plénière.
Comment juger alors ce qu’il faut bien considérer comme un échec et un « fiasco » ? En effet, si l’on fait abstraction d’une considération cependant peu négligeable, à savoir l’incidence de l’adoption du traité sur la reconsidération du problème en Allemagne fédérale, il est bien évident que l’opposition marquée par la plupart des pays occidentaux – et européens en particulier – aux règles de droit consacrées par le traité, risque de freiner très fort la réalisation des progrès que celui-ci était censé faire accomplir au niveau mondial. Mais cette résistance « idéologique » des pays occidentaux était-elle bien fondée ?
En Europe, par exemple, on n’a pas eu de mots assez durs pour condamner l’optique dans laquelle l’organisation mondiale avait envisagé la question. Le rapporteur chargé, à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, de provoquer de nouvelles initiatives en la matière au Conseil, n’a pas hésité à dire que le texte de l’O.N.U. contenait des « imperfections telles » qu’elles le rendaient « inacceptable ». M. René Cassin, pour sa part, annonçant l’abstention au vote final du pays qu’il représente, aurait déclaré que la France « ne pouvait admettre l’imprescriptibilité pour des délits sans conséquences ni caractères internationaux véritables ». C’est là faire un procès bien rapide et bien sévère du point de vue idéologique qui a prévalu.
En effet, il n’est plus aucun juriste qui pourrait aujourd’hui soutenir sérieusement que la politique d’apartheid ne débouche nécessairement sur des atteintes aux droits de l’homme qui en font bel et bien un « crime contre l’humanité » au sens large. La meilleure preuve en est l’affirmation qui en a été faite, déjà, par les Nations Unies dans une résolution antérieure et qui, à l’époque, ne fut pas mise en cause par ces mêmes pays occidentaux.
Ce que l’on peut déplorer, cependant, c’est le caractère effectivement diffus de l’amalgame que le traité formule dans sa définition du crime contre l’humanité. Sans doute eût-il convenu de procéder à une analyse moins hâtive et superficielle des concepts utilisés pour formuler une définition plus précise, plus cohérente et parfaitement adaptée aux exigences actuelles du droit international. Mais il fallait travailler vite, puisque le combat contre la prescription apparaît par nature comme une course contre la montre…
Et les Nations Unies n’avaient déjà que trop perdu de temps dans l’élaboration de l’instrument souhaitable. Peut-être alors eut-il été, provisoirement et quitte à reconsidérer la question, plus réaliste, pour parer au plus pressé, de réaliser un consensus sur une définition « classique » des crimes contre l’humanité. Mais ce sont là des considérations d’opportunité et de stratégie qui ne touchent pas au fond du problème. Alors que les juristes occidentaux ont justifié précisément leur position aux Nations Unies par des scrupules et une orthodoxie, un purisme strictement légalistes… Est-ce tout à leur honneur, pourtant, d’avoir fait, par leur abstention, le jeu des puissances coloniales (Afrique du Sud et Portugal) qui ont aujourd’hui le moindre souci de la protection des droits de l’homme ?
Disons encore que l’Assemblée générale a, le même 26 novembre, adopté une Résolution 2392 (XXIII) qui note que « la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ne fait pas obstacle à l’étude des principes qui pourront être affirmés dans l’avenir pour déterminer la nature des tribunaux constitués pour juger les personnes accusées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ».
Estimant que cette question est étroitement liée à celle de la juridiction criminelle internationale, elle se réserve de reprendre l’examen de cette question « à tout moment qu’elle jugera approprié ». Un internationaliste éminent, Charles De Visscher, s’exprimant en termes très généraux, nous dit très clairement ce qu’il en est, par exemple de la prescription extinctive : « L’observation démontre que tout droit longtemps négligé s’affaiblit par le non-usage ; le temps écoulé jette un doute sur son existence, il entame la croyance en son fondement.
D’autre part, une bonne administration de la justice veut que toute contestation ait un terme (ut sit finis litium), car, des poursuites tardives sont un ferment d’insécurité ; elles placent le débiteur recherché dans un état d’infériorité inéquitable ». Pourtant les juristes – et les internationalistes ne font pas exception – soulignent volontiers le caractère quasi irrationnel de l’institution sur le plan du droit, en relevant, comme Cavaglieri, par exemple, que l’écoulement du temps ne contient par lui-même aucun élément juridique. Et Pinto définit la notion comme donnant « le pas au fait sur le droit ».
Quant à Soerensen, il y voit « un état de fait qui s’est institué au mépris d’un droit que le titulaire néglige de faire valoir ». Verykios, quant à lui, rappelant la distinction du droit privé entre prescription acquisitive (ou usucapion) et prescription extinctive (ou libératoire), la notion cristallisant l’effet du temps, d’une part sur l’acquisition, d’autre part sur la perte de droits ou d’obligations, montre bien que, paradoxalement sans doute, « la prescription existe depuis qu’il existe un droit ».
Mais absolument alors le cadre du droit privé sans pour autant quitter les perspectives du droit interne, demandons-nous quelles sont la portée et la signification de la prescription de l’action pénale.
La majorité des auteurs paraissent s’être rangés à l’avis de l’Institut de droit international et, plus particulièrement, des rapporteurs, N. Politis et Charles De Visscher, qui avaient inspiré la résolution adoptée par celui-ci. C’est toujours au nom de ces considérations sociales « d’ordre, de stabilité et de paix » qu’ils ne prononcent alors en faveur du respect de la règle, considérations que le professeur Charles de Visscher, revenant en 1960 sur la question, a jugées même « plus impérieuses encore dans les rapports internationaux que dans l’ordre interne ».
À ses yeux « le défaut d’effectivité est à la longue fatal à la survivance des droits » et « cette idée maîtresse, valable dans tout système de droit », s’applique aussi aux réclamations par lesquelles un État exerce, par exemple, sa protection diplomatique en faveur de l’un de ses ressortissants. Point de vue partagé par Verykios qui voit là, lui aussi, un principe général de droit reconnu par les nations civilisées non parce que la règle est reçue du droit interne de tel ou tel pays, mais parce qu’elle est reconnue par tous les pays.
Le « législateur international » aurait tout simplement omis de prévoir l’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité parce qu’elle « irait de soi », en quelque sorte. Dangereuse assertion. Ce qui va sans dire, va encore mieux lorsqu’on prend la peine de le préciser.
En fait, il vaudrait mieux supposer que les auteurs des actes internationaux que nous avons envisagés ne se sont même pas posé la question de la prescription, en présumant qu’au terme d’un délai donné (le délai normal de prescription des crimes de sang prévu par maintes législations étant de vingt ans), la répression des crimes de guerre aurait été assurée et conduite à son terme ultime. Supposition qui implique évidemment un renvoi, fût-il relatif, du droit international aux règles du droit interne.
Mais on peut supposer tout aussi bien que, si le législateur international avait pu prévoir combien lente à réaliser serait l’œuvre répressive, il se fût délibérément refusé à admettre l’applicabilité en l’espèce des règles de prescription qui sont admises pour les crimes de droit commun.
On constate à quelles ambiguïtés on se trouve confronté et combien il s’est avéré nécessaire d’adopter une convention qui ait pour objet de dissiper les doutes à cet égard.
Si l’on s’avise alors de comparer et de confronter les définitions, quelquefois fort vagues, des crimes de guerre et contre l’humanité qu’ont formulée ces instruments, un commun dénominateur propre à celles-ci se dégage de leur analyse : le degré de gravité très particulier des actes commis. Si l’on veut bien rapprocher, du reste, ces définitions de celle, plus large, qui fut, en définitive, adoptée dans la convention sur l’imprescriptibilité, cette observation demeure valable : quelles que soient, en effet, les réserves que l’on puisse émettre, nous l’avons vu, sur le contenu de cette définition et l’amalgame qu’elle constitue, on peut difficilement nier l’exceptionnelle gravité du crime d’apartheid, par exemple.
Nous savons, à propos de la définition du génocide, en particulier, quelles polémiques et controverses avaient quelquefois divisé la doctrine sur le contenu de ces définitions. Mais même si, pour certains, le génocide, par exemple, ne se définit que comme une manière de « sous-produit » du crime contre l’humanité, son caractère de gravité comparable sinon identique à celui-ci ne fait pas de doute. Pour nous en convaincre, examinons donc l’usage qui a pu être fait de ce concept à l’occasion de conflits récents ou actuels.
Comme chacun sait, le génocide figurait au nombre des crimes reprochés au gouvernement des États-Unis par la Commission d’enquête connue sous le nom de « Tribunal Russel ». Dans plusieurs rapports et particulièrement dans ceux que Me Matarasso et M. Phan van Bach ont déposés devant cette Commission, il a été imputé au Gouvernement américain en tant que crime international suprême et aboutissement de l’ensemble des crimes internationaux (de guerre, contre la paix et contre l’humanité) dont la perpétration était considéré comme avérée par ledit « Tribunal ». Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir de la légitimité et du fondement du soi-disant « tribunal » réuni à Stockholm, il ne peut guère faire de doute que si, demain, le Gouvernement des États-Unis avait à répondre devant une authentique juridiction criminelle internationale d’un certain nombre d’actions commises par lui dans le cadre du conflit vietnamien, il ne repousserait pas aisément les accusations de génocide ou de crimes contre l’humanité portées contre lui…
Dans le champ du droit commun, le principe de la légalité des délits et des peines trouve évidemment tout son sens. En irait-il autrement que le justiciable se verrait voué à la plus grande insécurité juridique et à l’arbitraire. Et cela en dépit du caractère en fait paradoxal de la règle puisqu’ainsi qu’on peut le faire observer : « le premier juge n’a-t-il pas précédé la première peine ? ». Mais sur le terrain où nous nous trouvons place, celui du droit international et « dans la répression des crimes de guerre, le juge ne précède pas seulement la loi, il l’entraîne ». Quant à ces crimes, il serait d’autant plus aberrant et scandaleux de voir la justice demeurer impuissante qu’on pourrait se demander, avec Graven, si « la seule énormité ou l’ampleur du crime serait alors une raison d’impunité ? ».
On ne peut que convenir en l’espèce que l’application du principe se trouverait « en contradiction flagrante avec les exigences les plus élémentaires de la politique criminelle ». Concluons, comme l’a fait Henri Levy-Bruhl, que : « s’il est bien certain que les agissements des chefs du IIIe Reich n’étaient pas tous sanctionnés par la loi (…) ils ont suscité une telle horreur dans la conscience universelle que l’on a estimé à juste titre qu’il était plus conforme à la justice de contrevenir formellement à un principe de droit écrit que de laisser impunis d’abominables forfaits ».
Aussi le droit des gens écarte-t-il l’application de la règle en la matière. C’est ainsi que, par exemple, la loi no 10 de contrôle allié, dans la mesure même où elle ressortit au droit international, reste étrangère à l’application du principe. Et il en va de même pour tous les instruments de droit international, en particulier pour ce qui touche aux infractions qui nous intéressent. L’article 7 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par exemple, exclut toute applicabilité du principe relativement « au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
De tout ce qui précède découle donc une constatation majeure : l’inapplicabilité des règles qui régissent en droit interne la prescription aux crimes internationaux. Nous avons pu déjà constater combien même sur le plan du droit interne la notion demeurait discutable et controversée, en tout cas pour ce qui concerne les crimes dits « atroces » ou « de sang ». Nous avons pu voir, du reste, qu’il s’agissait d’une règle de droit purement formelle, technique, procédurale, et non normative ou matérielle. À cet égard, nous avons rappelé les quelques présomptions qui la fondent aux yeux de législateurs internes qui l’ont reconnue.
À considérer même qu’un débat sur la possible « exportation » de ces présomptions sur le terrain du droit des gens puisse se concevoir, voyons ce qu’il adviendrait de la prise en considération de ces critères.
Pourrait-on raisonnablement retenir la présomption du repentir ou de l’amendement du coupable ? On sait que c’est la l’argument fondamental des partisans de la prescription. « Le temps efface tout et modifie les criminels comme les autres hommes. Celui que l’on juge aujourd’hui n’est plus celui qui, il y a vingt ans, a commis ces atrocités.
Depuis lors il a pris conscience du caractère abject de celles-ci… », etc. Ou encore invoquerait-on la « punition par la peur ? ». Le coupable, censé s’être terré durant un certain nombre d’années sans connaître ni trêve ni repos, aurait par la même, et de cette façon, d’ores et déjà expié. Bien qu’il s’agisse là de présomptions invérifiables – ce qui est le lot et même parfois la raison d’être de la plupart des présomptions – et de véritables « paris » sur l’évolution et le changement d’état d’esprit de ceux qu’elles concernent, on ne saurait, sans mauvaise grâce, ignorer la portée de l’argumentation.
Certes les années qui séparent l’homme de ces actes, aussi graves soient-ils, peuvent apparaître a priori singulièrement chargés d’épaisseur et de mystère. Il est cependant difficile au législateur de tenter d’élucider ce mystère. Il est cependant difficile au législateur de tenter d’élucider ce mystère-là in abstracto. Ce père de famille irréprochable, ce fonctionnaire exemplaire, cet électeur sans tâche qui aurait, d’une certaine façon, pris la place du tortionnaire d’Auschwitz ou de Bergen-Belsen et emprunte son identité, il incombe au juge de l’identifier et, par diverses mesures, d’individualiser son cas, quand ce n’est pas à l’exécutif, par des mesures de grâce ou d’amnistie.
Mais quand on analyse, en l’occurrence, les débats judiciaires qui ont suivi l’inculpation des criminels de guerre nazis, et en particulier le procès des « bourreaux d’Auschwitz » à Francfort, on découvre que le cynisme de la plupart des inculpés atteste assez combien peu ils se sont « moralement rachetés ».
Pourrait-on, d’autre part, invoquer sérieusement en l’espèce le dépérissement des preuves ? Mais bien loin d’avoir dépéri, les preuves n’ont cessé de se multiplier… Tout s’est même passé comme si, quelquefois, vingt ans s’étaient révélés nécessaires pour élucider certains aspects, parmi les plus importants, de la criminalité nazie. Au point que certains parmi ceux-là mêmes qui en avaient le plus souffert n’aient pu, qu’au fil du temps, prendre vraiment conscience de l’ampleur et de l’atrocité des faits commis.
À l’heure actuelle les témoignages s’accumulent et l’opinion publique prend connaissance de pièces encore inédites du « dossier ». C’est assez dire combien il serait mal venu de se retrancher derrière pareille présomption pour « passer l’éponge ». Ce serait faire table rase d’un phénomène pathologique dont, aujourd’hui encore, nous ignorons certaines facettes et dont seule la divulgation qui en sera poursuivie à l’avenir permettra de prendre toute la mesure.
Quant au trouble causé par la perpétration du crime, n’aurait-il pas survécu dans la conscience sociale ? L’exigence de la répression se serait-elle atténuée dans l’opinion publique ? La réponse, ici, doit être plus nuancée et même ambiguë. Indéniablement, il est une certaine opinion publique, allemande en particulier, il faut bien le souligner, qui non seulement n’aspire plus au châtiment des coupables, mais encore se montrerait plutôt encline à réclamer la cessation des poursuites. Mais il en est une autre qui, pour des raisons assez évidentes, se montre moins portée à l’indulgence.
Manifestation d’ailleurs éloquente du caractère intrinsèquement international des crimes commis, c’est que l’opinion publique internationale apparaît, dans son ensemble, intéressée par la question et qu’elle se divise à son propos. La prise en considération d’une présomption de ce genre en ce qui regarde un phénomène de criminalité d’État apparaît du reste proprement inconcevable. Une partie de l’opinion n’apparaît pas assez intéressée pour que sa prise d’attitude soit relevant et l’autre ne l’est que trop, soit complice, soit victime… Au nom de qui, en définitive, telle ou telle opinion encouragerait-elle (ou refuserait-elle) la mise en application de la prescription ?
Que la « conscience universelle » demeure, toutefois, troublée, vingt ans après, par les aspects les plus pathologiques de la criminalité nazie, il n’est qu’à voir le nombre d’archives, de documents et de témoignages qui sont édités chaque année à son propos pour le mesurer. Peut-être n’a-t-on jamais autant qu’aujourd’hui analyse le traumatisme que ces événements ont suscité.
Mais enfin et surtout cette discussion demeure théorique dans la mesure même où ces infractions intéressent, d’une manière générale, dans leur essence même, l’ordre public international et concernent la communauté des États. À cet échelon, au niveau du droit des gens où il convient de situer le problème, les règles que nous venons d’évoquer ne s’imposent aucunement et n’ont plus cours.
On ne conçoit pas d’application de la « loi de l’oubli » pour des crimes qui ont été perpétrés contre la communauté des nations et l’humanité en tant que telle. Ces crimes sont imprescriptibles par nature. Si, pour des raisons techniques, ces crimes ne peuvent, dans l’état actuel de l’évolution du droit positif, n’être réprimés que sur le plan interne, ce doit être en conformité avec le droit international et en reconnaissant à celui-ci la primauté qui lui est due.
Mais il est temps, pour conclure, de dépasser les perspectives du précédent nazi et nous placer, une dernière fois, à un point de vue tout à fait général.
Cependant, et en ce qui concerne précisément le crime de génocide, l’Assemblée générale, dans sa résolution 96 (I) du 11 décembre 1946, avait déjà affirmé que la répression du crime de génocide constituait « une affaire d’intérêt international » et « un crime de droit des gens ». Recommandation était, ici aussi, faite aux États de légiférer en sorte que ce crime fût réprimé et qu’une collaboration internationale fût assurée pour y parvenir.
À l’instar des autres crimes internationaux, la notion ainsi mise à jour ne constituait pas un « fait nouveau ». Emmanuel Berl souligne, à cet égard, que « la première démarche d’une lutte contre le génocide doit être de rappeler que la plupart des sociétés l’ont commis ou ont incliné à le commettre ».
D’une manière générale, quiconque, tandis qu’il participe à un complot visant à la destruction ou l’affaiblissement d’un groupe national, racial ou religieux, commet un attentat contre la vie, la liberté, la propriété de membres d’un tel groupe, est coupable du crime de génocide.
Grosso modo, cette définition recouvre les actes énumérés dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1948 et qui est entrée en vigueur le 12 janvier 1951.
Par une peu justifiable omission, la notion ne recouvre pas les mesures d’extermination dirigées contre un groupe politique. C’est sans aucun doute là l’une des plus grandes imperfections de la notion ainsi dégagée et c’est ce qui lui a valu le plus de critiques de la part des commentateurs.
De même, le fait d’avoir fait du génocide un crime distinct des autres crimes contre l’humanité n’a pas satisfait maints juristes tels Graven, Pella et surtout Aroneanu. La différence essentielle qui a été faite entre la notion de génocide et celle de crimes contre l’humanité considérés dans leur ensemble, réside essentiellement dans une particularité de l’intention de l’agent qui le commet : tandis que chez les auteurs de crimes contre l’humanité, il s’agit pour l’agent d’attaquer l’individu ou même plusieurs individus en raison de leur conviction politique ou de leur appartenance à un certain groupement racial, religieux ou culturel, dans le cas du génocide, il s’agit pour l’auteur en attaquant l’individu de détruire ou de persécuter des entités humaines (en tout ou en partie) en raison de leur caractère particulier d’ordre national, ethnique, racial ou religieux.
Prescrire, aujourd’hui, ce qui s’est passé hier, ce serait dans une certaine mesure accepter déjà ce qui se passe aujourd’hui même et peut encore se reproduire demain. Ce serait, en quelque sorte, normaliser le génocide une fois pour toutes. Et ce serait, également, renoncer par avance à user d’un moyen d’empêcher que ces crimes se reproduisent.
Songeons que le « tribunal de papier » devant lequel la Commission Russel a traduit les américains pourrait bien, devrait bien laisser la place, un jour prochain, à un vrai tribunal…
Il ne faut point laisser au droit la latitude d’abdiquer. On ne peut permettre à la justice de céder à une tentation qui ressemblerait, à s’y méprendre, à celle de la lassitude. Ce ne serait pas seulement désespérer de l’histoire ; ce serait désespérer de l’homme lui-même. Et puisse cela ne pas nous être permis.
En résumé, ces crimes dont parmi eux le crime de génocide, sont couverts par le principe d’imprescriptibilité définit par la Convention de 1968.
Rodney Dakessian
Beyrouth le 28-Avril-2014